
TPE GAZ DE SCHISTE
L’exploitation du gaz de schiste :
déclenchement d’une révolution pétrolière ou simple illusion ?
Exploration et exploitation
Le gaz de schiste est principalement composé de méthane CH4 (1 carbone, 4 hydrogènes, à 94%).
Le dernier puits est le puits de développement qui est la phase d’exploitation du gisement.




Dans le monde, les ressources en gaz de schiste seraient du même ordre de grandeur que celles de gaz conventionnel, et ces ressources seraient même mieux réparties: des ressources estimées à 36 000 milliards de mètres cubes en Chine, ou encore à plus de 25 000 milliards de mètres cubes aux Etats-Unis, où l'exploitation est déjà en marche. Certains pays s’ouvrent peu à peu à l’exploitation de ces gaz, mais d'autres au contraire, semble y prendre garde. En Europe, les cas diffèrent et le débat d'une éventuelle exploitation est depuis plusieurs années ouvert, sujet sensible et polémique.
Qui a dit « OUI », qui a dit « NON », et surtout POURQUOI ?
Un schiste est une roche qui a la particularité de se présenter sous un aspect feuilleté et de se débiter en plaques fines.
L'origine du gaz de schistes se confond avec celle du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Tous ces matériaux se sont formés il y a des millions d’années, quand certaines conditions favorables étaient réunies.
Riches en carbone, ils dérivent de la transformation de la matière organique. La grande période de leur création est le Carbonifère, à la fin du Paléozoïque il y a 359 à 299 millions d’années.
sable butimineux
Gaz de schiste : de quoi s'agit-il ?

La formation de ces matériaux énergétiques requiert un milieu riche en matière organique. Cette matière, constituée de fragments d’animaux et de végétaux, va s'enfouir rapidement par l’arrivée de sédiments venant la recouvrir.
Suite à cet enfouissement, les sédiments en majorité argileux et riches en matières organiques vont voir ces dernières se transformer en fonction de la profondeur :
-
0 - 1000 mètres : sous l’action des bactéries, la matière organique va se transformer en gaz naturel (méthane) que l’on va appeler "biogénique" (=produit par la vie). Ce gaz n’est pas produit en grande quantité et n’est pas de grande qualité car il est associé à d’autres composés comme l’eau, le CO2 ou le soufre.
-
2000 – 3000 mètres: la matière organique va se transformer sous l’action de l’augmentation de la température. On va parler de maturation thermique et de transformation thermogénique (=produit par la chaleur). A ce stade, les matières organiques sont transformées en huile (pétrole) avec un peu de gaz naturel.
-
3000 – 4000 mètres et plus : le gaz naturel est produit en plus grande quantité. Au-delà de 4000 mètres, le gaz naturel devient sec et est très recherché car très pur.

On parle alors d’hydrocarbures fossiles, puisqu’il s’agit d’organismes enfouis et transformés et que le charbon, pétrole et gaz sont constitués de deux types d’atomes, l’hydrogène et le carbone. Ils constituent donc d’excellents combustibles. Leur combustion produit du CO2 et de la vapeur d’eau. En effet, la combustion est une réaction d’oxydation, de réaction entre l’hydrocarbure et l’oxygène de l’air : si l’on prend un hydrocarbure simple, le méthane (molécule=CH4) sa réaction avec l’oxygène (molécule=O2) sera la suivante (avec deux O2) : CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Les hydrocarbures sont nombreux et peuvent être simples comme le méthane (CH4), composant du gaz naturel ou plus complexe comme l’octane (C8H18), composant du pétrole.

Migration des hydrocarbures



C’est sous cette forme que se trouve la très grande majorité des gisements exploités de pétrole et de gaz. Cette situation est en effet doublement favorable : les hydrocarbures y sont concentrés et non pas dispersés comme dans la roche-mère. Un simple trou dans la roche imperméable et tant le pétrole que le gaz s’échapperont.
En tant que gaz et liquide, les hydrocarbures migrent fréquement dans les roches jusqu’à ce qu’ils soient piégés. C’est la raison pour laquelle on parle de roche-mère et de roche-réservoir.
Le schiste, de nature argileuse, est
relativement peu perméable. Cependant, sous l’action de déformations tectoniques et grâce à la nature feuilletée du schiste, les hydrocarbures arrivent souvent à s’en échapper et à migrer dans des roches poreuses comme les grès ou les sables. Ils peuvent arriver à la surface mais le plus souvent ils seront piégés sous une couche imperméable où ils formeront un réservoir.
La roche-mère est la roche dérivant du sédiment riche en matière organique. Il s’agit donc d’une roche principalement argileuse que l’on appelle un schiste car elle a tendance à former rapidement des feuillets.
Les hydrocarbures restés dans la roche-mère : gaz de schiste


Cependant, si les schistes sont particulièrement imperméables ou s’ils n’ont pas été soumis à des forces tectoniques importantes, les hydrocarbures pourront rester dans leur roche-mère. C’est le cas des schistes bitumineux et des schistes comprenant encore du gaz, que l’on appelle le gaz de schistes.
Ces hydrocarbures dans les roches-mères constituent des réserves importantes de combustibles, très difficiles d’accès par conséquent puisque situés en profondeur dans des roches très peu perméables. Ces gaz sont dits alors « non conventionnels » car issus de gisements composés d’argile litée et d’autres roches à grain fin et durs à atteindre. Le gaz y est emmagasiné de trois façons :
1 - adsorbé par une matière organique insoluble appelée kérogène
2 - piégé dans les espaces poreux des sédiments à grain fin interstratifiés avec l’argile litée
3 - confiné dans les fractures du schiste argileux
Les gaz formés à haute température et en grande profondeur (au moins 2 ou 3 km) se trouvent alors en zones de schistes. Ces zones, plus ou moins épaisses, de quelques dizaines à quelques centaines de mètres d’épaisseur, mais pouvant s’étendre sur de très grandes surfaces, deviennent ainsi des gisements de gaz extrêmement importants, de plusieurs centaines ou milliers de milliards de mètres-cubes et répartis sur des centaines ou des milliers de km2. Une grande quantité de gaz est alors présente, mais difficile à récupérer.
Comment déterminée les zones potentiellement exploitables, et de quelle facon extrait-on cette ressource ?
La campagne sismique
Le principe sismique : provoquer de légers ébranlements et suivre les signaux ainsi émis, qui réfléchissent sur certaines discontinuités géologiques.
La découverte et l’évaluation du champs
Les géologues reconstituent les couches géologiques du sous-sol et définissent des “prospects” ou des gisements potentiels. Puis les forages d’explorations sont nécessaires pour confirmer la présence d’hydrocarbures dans le gisement.
La campagne sismique a pour objectif d’obtenir une construction d’un modèle en 3 dimensions du sous-sol, permettant le positionnement précis des forages. Elle fournit donc une échographie.

Forage : ensemble des techniques permettant de creuser un puits jusqu'à des profondeurs parfois très élevées.
Le gisement est développé puis mit en production si le coût et la quantité des ressources sont satisfaisants.
Les modèles numériques des gisements sont réalisés sur l’ordinateur :
- Ils estiment le volume de pétrole et de gaz en place dans le réservoir avant la mise en production du gisement
- Ils simulent l’extraction des fluides contenue dans la roche réservoir

Les puits d’exploration
Ces puits permettent de :
-
Vérifier la présence d’hydrocarbures.
-
Recueillir des données afin de définir la nature des couches géologiques et du fluide contenu dans la roche.
-
Acquérir les premières données concernant la zone d’intérêt (comme pression initiale, la température, la perméabilité, la productivité).
-
Déterminer s’il convient de poursuivre le forage ou d’abandonner.

Les puits d’appréciations
Ces puits permettent de :
-
Préciser les informations données par le puits d’exploration pour déterminer les caractéristiques du réservoir, son extension et son volume.
-
Évaluer la taille de la découverte.
-
En déduire une production potentielle et décision de développer ou non le champ.
L'exploitation
Le forage :
Le gaz de schiste est donc localisé de façon diffuse dans une couche de roche-mère très étendue et imperméable. Un puits classique à la verticale ne permettrait donc que d’en extraire une infime partie. Les exploitants ont donc développé des techniques de forage incliné, de façon à suivre une couche de gaz sur une longueur comprise entre 1 000 et 2 000 m. Cette méthode permet de réaliser des forages en étoile (forages horizontaux dans plusieurs directions) donc d’extraire une quantité plus importante de gaz.
Le principe de l'exploitation du gaz de schiste est simple : on fore un trou pour atteindre le schiste situé en profondeur, on fracture le schiste pour permettre au gaz de mieux circuler et on récupère le gaz par le même trou de forage.
En pratique, les problèmes sont nombreux.


ÉTAPES DE L'EXTRACTION
Le tubage :
Afin que le trou ne s’écroule pas et aussi pour éviter la contamination des nappes phréatiques, on effectue un tubage. On introduit des tubes de ciment dans le trou, ce qui réduira le diamètre du trou d’environ 30cm.

Les gaz de schiste dans le monde

La méthode du « fracking » :
On commence par réaliser des petites explosions afin de créer des premières petite fracture puis on injecte un fluide (mélange d’eau de sable et de produits chimique) à très haute pression (600 bar) ce qui permet d’agrandir les fractures déjà créées.
Dans un schiste, les espaces interstitiels dans lesquels le gaz peut circuler sont 1000 fois plus petits que dans les nappes constituant les gisements traditionnels. Entre les pores, les espaces sont encore plus petits, de l’ordre de 20 fois plus grands qu’une molécule de méthane. Les fractures peuvent alors permettre au gaz de circuler plus facilement mais souvent, elles ne sont pas interconnectées et le gaz reste malgré tout piégé au sein du schiste.
Les fractures naturelles du schiste ne suffiront donc pas à exploiter le gisement de gaz. Elles ne sont pas assez nombreuses et surtout elles ne communiquent pas assez entre elles. L’exploitation va donc créer des fractures artificielles en utilisant la méthode de la fraction hydraulique. C’est une méthode bien connue et largement employée par l’industrie pétrolière et gazière pour améliorer l’exploitation des réservoirs de faible perméabilité.
La fracturation hydraulique permet de créer des micro-fractures (quelques millimètres de large) qui ouvrent la roche-mère latéralement sur des distances de l’ordre de la centaine de mètres et libère le gaz de schiste. On a recours aujourd’hui à la technique du « multifracking », soit une dizaine de fracturations par puits. La fracturation hydraulique nécessite d’injecter dans le puits, à très haute pression et via un tubage adapté, un mélange d'eau, de sable et d’additifs.

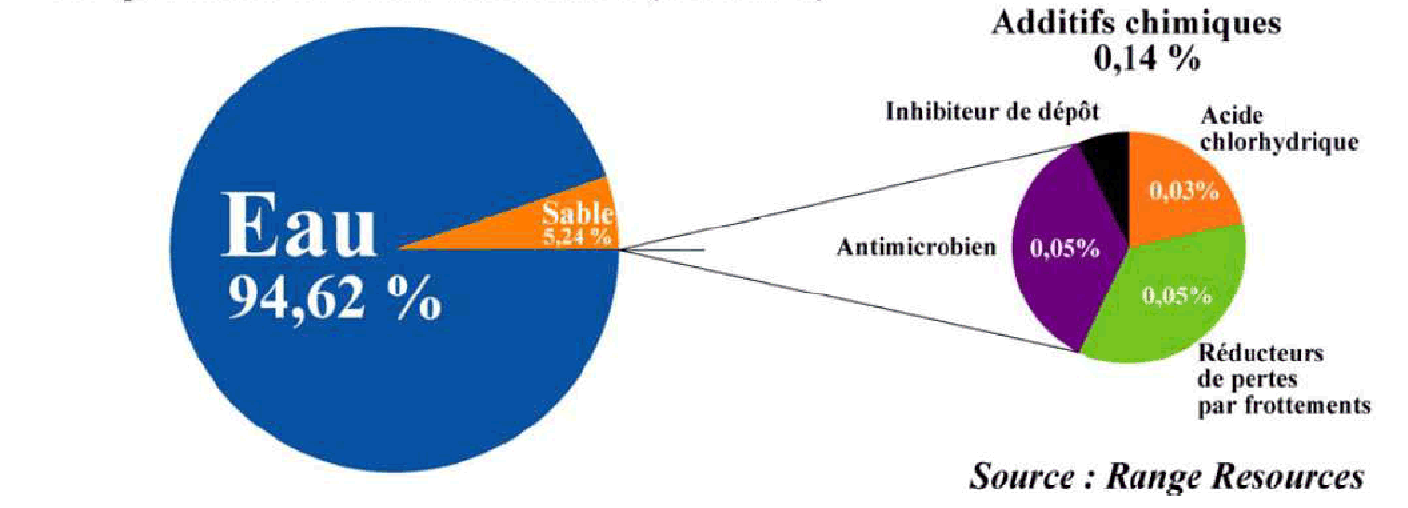
Deux facteurs sont importants à considérer afin d'extraire les gaz de schiste:
- la nature et la composition du schiste. L’argile a tendance à absorber l’augmentation de pression, elle plie sous la pression hydraulique exercée sans casser. C’est le roseau de Jean de La Fontaine. Par contre, si le schiste est riche en quartz (silice) voire en calcite, il va se fracturer beaucoup plus facilement. Le quartz est bien plus dur que l’argile, mais il est plus cassant. De plus il crée des hétérogénéités au sein du schiste, ce qui favorise également la fracturation.
- la pression interne du schiste. Comme le gaz naturel ne peut s’échapper du schiste en raison de la faible perméabilité de ce dernier, il s’accumule et augmente la pression interne du schiste. Dans le cas d’un schiste avec une forte pression interne, les fractures artificielles vont se propager plus facilement puisque le schiste est déjà naturellement proche du point de rupture. La surpression hydraulique vient s’ajouter à la surpression existante du gaz.
Méthode d’extraction :
LA FRACTURATION HYDRAULIQUE
L’eau sous pression ouvre des fissures par lesquelles le gaz pourra s’écouler.
Le sable, en s'infiltrant dans ces fissures, empêche qu’elles ne se referment ultérieurement.
Les additifs (moins de 1% de l'ensemble) sont essentiellement des substances bactéricides pour empêcher la contamination du réservoir par des bactéries provenant de la surface, des composés visqueux servant à maintenir le sable en suspension dans l'eau puis à le maintenir dans les fissures et des réducteurs de friction.



Enfin, on pompe l’eau pour laisser la voie libre au gaz qui remonte par le tube de forage jusqu’à la surface. Il est récupéré dans des réservoirs, raffiné et évacué par gazoduc.
Un forage est composé:
-
d’un derrick: le support du système de forage, c’est une tour métallique d’une trentaine de mètres de hauteur qui permet de maintenir les tiges de forages verticalement, et d’en introduire des nouvelles.
-
d’une tige: elle mesure environ 9m, au fur et à mesure du forage, on rajoute des tiges en les vissant les unes aux autres. Au bout de la première tige, il y a l’outil de forage, un trépan.
-
d’un trépan: c’est l’objet qui permet de forer. Grâce à ses dents, il broie la roche en petit morceaux.
Lors de notre voyage à Paris, un chercheur nous a proposé une experience facile à réaliser. Il s'agit d'une modélisation de la facturation hydraulique dans de la gélatine. Nous avons injecté grâce à une pipette, de l'eau colorée avec le plus de pression possible afin de créer des fractures.
La porosité et la perméabilité définissent la qualité d'une roche réservoir.
La porosité est l'espace entre les grains de la roche dans lequel sont stockés les hydrocarbures.
La perméabilité mesure l'aptitude de la roche à laisser les différents pores communiquer entre eux. Elle est exprimée en Darcy et elle est de l'ordre du nanodarcy dans le cas des gaz de schiste.
Les gaz de schiste sont piégés dans des roches très peu perméables. Ces roches ultra-compactes ne permettent donc pas au gaz de circuler.
